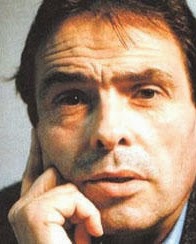Le succès est quantifiable : à 100.000 exemplaires, il ne fait pas de doute, et une vente à 10.000 est de bon augure pour un auteur hier inconnu du grand public. Les revenus sont en conséquence : dans le premier cas, je frôle la taxation sur la grande fortune; dans le second, j'ai gagné chichement mon année. Mais la plupart des écrivains sont plus intéressés par la notoriété que par le fric.
Etre connu d'une infinité de gens que je ne connais pas est extrêmement troublant et, il faut bien le dire, agréable. On gagne en "surface", selon l'expression consacrée, qui, toute commerciale qu'elle soit, traduit assez bien cette impression d'augmenter sa vie en extension. On existe au-delà de soi-même, porté par une foule bienveillante. C'est peau de balle, ça ne tient pas à l'analyse, mais c'est rassurant. On se rassure comme on peut, tel ce personnage de Calvino qui a truffé sa maison de hauts-parleurs et embauché des gens pour prononcer son nom 24 heures sur 24.
Tout le monde rêve de célébrité à un moment de sa vie. L'enfant se projette en fils de roi dans le "roman familial" établi par Freud (et où Marthe Robert voit l'origine du roman littéraire). L'adolescent "se voit déjà" vedette de la chanson ou footballeur international. Hors du lot, au-dessus du lot. Les Star Académie et autres Loft Story jouent là-dessus. Ça concerne surtout les jeunes. On en "rabat" en vieillissant, à mesure que la vie se rétrécit.
L'écrivain, lui, ne cesse de courir après une forme de gloire. A chaque nouveau livre, il se dit que c'est peut-être le bon, celui qui va enfin "le faire décoller", "le faire connaître", comme si les précédents comptaient pour du beurre sous prétexte d'une vente insuffisante. Etrange, non ? 1000 bouquins vendus, c'est quelque 3000 lecteurs, ce n'est pas rien, ça fait un joli halo autour de ma petite vie. L'écrivain serait-il un éternel adolescent? Se bercerait-il indéfiniment de rêves de midinette? Non. S'il y a quelqu'un qui réfléchit sur l'existence et en affronte les questions sans fond, c'est bien l'écrivain (du moins le bon écrivain, car il y a des écrivassiers !) Je ne peux pas le soupçonner d'une telle faiblesse d'esprit.
L'explication me semble résider dans le statut de l'auteur, qui s'est formé au siècle romantique. L'auteur s'est perché au-dessus du lot, habité par l'inspiration, jouissant d'un état de grâce, qui est un don des dieux. En termes moins emphatiques: il a un talent qui le distingue. Le talent ne fait pas tout, il faut du travail, de la patience etc., mais il ne se décrète pas, on l'a ou on ne l'a pas, et il fonde la qualité d'écrivain. Sans talent, à force de besogne ou grâce à son entregent, on pourra peut-être publier, mais on ne sera jamais un vrai écrivain. De plus, l'auteur est uncréateur, il fait advenir des choses radicalement nouvelles, qui ne ressemblent qu'à lui-même, qu'il ne doit donc qu'à lui-même. A la sortie des Fleurs du mal, Flaubert écrit à Baudelaire pour le féliciter: "Vous ne ressemblez à personne, ce qui est la première de toutes les qualités." Flaubert est précisément le parangon de l'auteur romantique, "premier Adam d'une espèce nouvelle : celle de l'homme de lettres comme prêtre, comme ascète et comme martyr", a dit de lui Borgès.
Telle est l'image qui colle à l'écrivain. C'est un être à part, entièrement consacré à son art, avec une responsabilité écrasante : il est chargé de la littérature de son temps ! Aussi est-il souvent présenté par les éditeurs et les journalistes avec une emphase ridicule :
– "l'un des plus grands écrivains français vivants";
– "un auteur qui a complètement renouvelé le genre";
– "l'une des figures les plus déroutantes du roman français";
– "à coup sûr ce roman deviendra un grand classique"
– "un écrivain au premier rang des lettres françaises"
– "le roman français devra désormais compter avec cet auteur".
Je ne résiste pas à l'envie de citer le charabia de Pietro Citati parlant de Gesualdo Bufalino :"Pour lui, seul existe le livre. Le Ciel et la Terre n'ont été créées, l'homme n'est sorti de la glaise que pour qu'un livre parle d'eux. Le livre est l'objet suprême qui réunit en lui toute la vie réelle, et la vie rêvée etc."
Et "y a pas à tortiller", comme disait mon père, pour être reconnu (et du coup se reconnaître soi-même), il faut jouer le jeu, et ça ne va pas sans une certaine "surface" ou "visibilité", donc un chiffre de ventes respectable, 10.000 au minimum, à condition de faire mieux la prochaine fois. Dans ce cas de figure, l'éditeur, qui est censé faire couple avec l'auteur, et qui est apparu à la même époque, début XIXème – l'éditeur vous donnera du "cher auteur".
Il suffit de tourner le dos à cette comédie. La décision est difficile à prendre, mais après, ça se fait tout seul et on s'en réjouit. C'est comme d'arrêter de fumer. Le précieux petit bouquin de Georges Picard, "Tout le monde devrait écrire", nous y aidera. Finie la navigation dans les hautes sphères, on retrouve la terre ferme, le plancher des vaches, l'odeur des vaches et le craquement du plancher. Pas besoin d'être spécialement intelligent ou de faire mine : on peut être con, c'est même une garantie, de mettre le raisonnement de côté, et on y va sans a priori et sans garde-fou, effrontément, tout nu. Con-nu. Il en sortira de temps en temps un truc qui palpite, qui scintille et qui fait un drôle d'effet. ce sera de la littérature. Quitte à passer pour un radoteur, je vous ressers la citation de Georges Picard : «Aujourd’hui, la littérature est entrée en résistance contre un ennemi qui n’a pas de visage, qui n’a que l’identité vague et grise de l’indifférence. Cela ne doit pas décourager la passion d’écriture, au contraire. C’est justement parce qu’il n’y a rien à attendre du médiatique et du social en général, qu’écrire ressemble de mieux en mieux à une vocation désintéressée. »